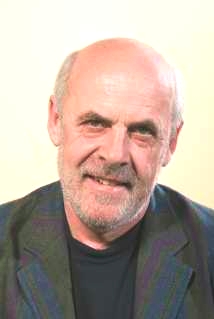Écrits d'Élaine Audet
Chercher dans ce site
AUTRES ARTICLES
DANS LA MEME RUBRIQUE
 Rarement un choix, la prostitution n’a pas que des causes économiques Rarement un choix, la prostitution n’a pas que des causes économiques
 La prostitution est soumise à la loi de l’économie néolibérale La prostitution est soumise à la loi de l’économie néolibérale
 Comment on transforme un être humain en marchandise sexuelle Comment on transforme un être humain en marchandise sexuelle
 L’essor du système proxénète dû à la mondalisation L’essor du système proxénète dû à la mondalisation
 Bibliographie générale : Le marché mondial du sexe au temps de la vénalité triomphante Bibliographie générale : Le marché mondial du sexe au temps de la vénalité triomphante
|
 |
|  |
 |
Ce texte fait partie d’un article intitulé « Prostitution, crime organisé et marchandisation » qui a été publié par l’auteur dans la Revue Tiers Monde (Paris, PUF, vol. XLIV. n° 176, octobre-décembre 2003 : 735-769). Sisyphe présente le dossier en cinq parties ou chapitres afin d’en faciliter la lecture sur Internet. Un lien à la fin de chaque texte permet d’accéder à la bibliographie générale.
*****
Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le produit criminel brut mondial atteint 1 200 milliards de dollars par an et constitue 15 % du commerce mondial (Passet et Liberman, 2002:60). L’explosion dans le nombre et dans la gamme d’organisations et de filières criminelles dans le monde entier est spectaculaire : " Les réseaux internationaux les mieux dotés (aptes à gérer l’ensemble du processus du début à la fin) se chiffreraient à une cinquantaine dans le monde. " (Dusch, 2002:13-14) Toutes les études soulignent le fait que le crime organisé joue un rôle capital dans l’économie mondiale depuis la libéralisation et la financiarisation des marchés. Pour Passet et Liberman (2002:57), grâce à la mondialisation néolibérale, l’essor de la criminalité économique est, en quelque sorte, devenue intrinsèque à la financiarisation du monde.
Pour Jean de Maillard (1998:15) " la mondialisation […] secrète une criminalité consubstantielle, inscrite dans la logique de nouvelles formes de production économiques et financières ". En effet, les organisations criminelles ne peuvent assurer le blanchiment et le recyclage de leurs gargantuesques profits qu’avec la complicité active des milieux économiques et financiers ainsi que du pouvoir politique. Pour Ernesto Savona (1998), la mondialisation a eu tendance à faire disparaître les frontières entre le crime économique et le crime organisé : pour ce chercheur, tout dans l’économie financière et spéculative d’aujourd’hui concourt à ce que les criminels économiques renoncent aux activités individuelles, opérées au petit bonheur, en faveur d’affaires organisées et continues.
Selon Savona, la mondialisation met une forte pression économique sur les entreprises " marginales " et fournit une incitation puissante en faveur de l’engagement de ces firmes dans le crime transnational. La croissance du commerce à l’échelle de la planète signifie qu’il y a beaucoup plus de transactions d’affaires et cela a pour effet de diminuer les risques de détection et d’arrestation par les autorités policières ou douanières. Le commerce accru et la libéralisation des marchés facilitent non seulement les transactions légales, mais également les transactions illégales.
L’affaiblissement des restrictions internationales et la croissance de la mobilité du mouvement des marchandises, de l’argent et des services ont créé de nouveaux marchés à l’échelle mondiale et de nouvelles occasions transnationales d’affaires. La mondialisation du commerce, l’accès facilité aux marchés étrangers et les avantages dus aux innovations technologiques ont permis à beaucoup d’entreprises d’étendre leurs activités au-delà des frontières et de chercher à les développer au niveau mondial [...] Le crime organisé a rapidement répondu à l’apparition du commerce et des réseaux financiers internationaux en adaptant ses structures organisationnelles et opérationnelles aux défis posés par des activités à l’échelle mondiale. Pour exploiter les occasions illégales des marchés dans d’autres pays, des organisations criminelles ont appris à exploiter à leur profit les contradictions entre les différents systèmes nationaux et financiers légaux. (Schloenhardt, 1999:8. Notre traduction). (1)
Pour plusieurs auteurs (Findlay, 1998 ; Ruggiero, 1996 ; Schloenhardt, 1999 ; Taylor, 1999 ; van Duyne, 1993), il importe de comprendre les origines et le développement des différentes activités du crime organisé en tant que formes particulières " d’entreprises " apparaissant dans des lieux particuliers en réponse à des besoins économiques particuliers (2). Ces chercheurs tentent de développer une compréhension de la criminalité organisée en termes d’offre et de demande. Selon ces auteurs, les activités du crime organisé contemporain se sont développées et s’appuient - d’une façon aussi bien informelle que formelle - sur des réseaux locaux au lieu d’être entièrement dirigées par des familles internationalement toutes-puissantes ou par des cartels ; il faut donc comprendre les origines des formes locales diverses de crime organisé comme les produits d’économies subissant " une transition vers la modernité (3) ".
Comme les plans d’ajustement structurel, la remise en question des mécanismes de protection sociale et des services publics en matière d’éducation et de santé, ont intensifié la pression migratoire, différents groupes, dont les organisations criminelles, profitent " des processus sociaux " enclenchés par la croissance des inégalités sociales et des pauvretés. La mondialisation a induit une croissance et une multiplication de formes de criminalité qui exploitent la délitescence sociale et économique de régions entières. Caldwell, Galster, Kanics et Steinzor (1997) soulignent ce facteur dans leur examen du rôle des différents groupes criminels en Russie dans la traite des femmes.
Bruinsma et Meershoek (1997) étudient le rôle du crime organisé aux Pays-Bas dans la traite de femmes de l’Europe de l’Est vers les Pays-Bas. Pour sa part, Phongpaichit (1997) considère l’organisation du " marché sexuel " en Thaïlande, entre autres, en termes d’activités criminelles tant en Thaïlande qu’au Japon. Savona, Adamoli et Zoffi (1995) montrent que les Yakusa dominent le système proxénète au Japon et la traite de femmes entre la Thaïlande et le Japon. La traite des femmes et des enfants est donc imbriquée étroitement à l’économie et à la finance mafieuses. Les organisations criminelles, qui règnent sur la traite des femmes et des enfants au profit du système proxénète qu’elles contrôlent, utilisent la terreur et disputent à l’État le monopole de la violence. Dans ce texte, la notion de crime organisé renvoie à de telles organisations criminelles.
Rejet des migrants dans l’illégalité
Certes, la pression migratoire, son caractère de masse, dans cette ère de mondialisation, va de pair avec une internationalisation accrue du crime organisé. Toutefois, il faut émettre ici une réserve. À cause de la mobilité des capitaux et des dérégulations financières, l’idée que la mondialisation n’est pas contrôlée par les États, a pour conséquence, dans les documents internationaux, de considérer les migrants comme des victimes de diverses formes de crime organisé (4). Comme l’État " ne contrôle plus l’immigration ", il renforce son appareil législatif et répressif, avec l’aval des organisations internationales (Moulier Boutang, 2000). Plus précisément, les organisations internationales, en particulier l’Organisation des Nations Unies (ONU), ont couplé la lutte contre la criminalité organisée et la lutte contre l’immigration dite clandestine.
En criminalisant les migrants " clandestins ", les " irréguliers " ou les " illégaux ", les États et les organismes internationaux ont, en quelque sorte, créé le crime (5). Ils ont créé le crime car, bien qu’ils défendent la libre circulation des capitaux et des marchandises, ils refusent le droit de libre circulation aux humains et, par le fait même, leur droit au travail et à une vie décente. Le fait qu’une part de plus en plus importante de la migration internationale est " illégale " facilite les abus de toutes sortes et la surexploitation. Les États criminalisent (6) également toutes les personnes qui sont impliquées de proche ou de loin dans les filières migratoires ; tout " groupe structuré de trois personnes ou plus " (7) est désigné comme une organisation criminelle. Cette définition du crime organisé inscrite dans la Convention de l’ONU contre la criminalité transnationale apparaît douteuse lorsqu’on la compare avec ce que représentent des organisations comme les Triades, les Yakusa, la Mafia, etc. (8) À ce propos, Moulier Boutang (2000) souligne un point fondamental : les migrants s’organisent.
Oui, les migrants s’organisent pour passer les frontières, ont recours aux passeurs comme la population des campagnes avait recours aux gabellous (les contrebandiers du sel) sous l’Ancien Régime. Oui, les migrants doivent s’endetter, donc avoir recours à des " tontines " communautaires plus ou moins régulières fiscalement, ou bien à des prêteurs dont ils connaissent le plus souvent les motivations, les pratiques. Mais cela n’implique pas pour autant que l’immigration, à partir du moment où elle est organisée (découverte qui relève d’un truisme, d’une vérité de La Palice), est structurée de façon criminelle, ou bien présente une analogie avec les différentes formes de mafia, une prédisposition à la criminalité.
La difficulté même du contrôle des migrations par les États montre l’autonomie du fait migratoire par rapport aux politiques censées l’encadrer, si bien qu’une partie de la migration internationale verse dans l’illégalité de masse et, à un degré beaucoup plus restreint, dans la grande criminalité organisée. Il faut interroger la responsabilité des sociétés de départ et celles des pays d’accueil. Par exemple, l’étude de Phongpaichit (1997) sur le " trafic des femmes " de Thaïlande montre que l’origine de ce phénomène tient à l’encouragement à l’émigration, au cours des années quatre-vingt, par le gouvernement.
Le développement de la traite des femmes au Japon, contrôlé désormais par les Yakusa, est le résultat de la migration antérieure de travailleurs masculins qui ont encouragé l’émigration de Thaïes d’âge mariable. La corruption des douaniers et des fonctionnaires des pays de départ, de transit et d’accueil a rapidement permis une domination par des organisations criminelles des flux migratoires entre le Japon et la Thaïlande, ce qui a, à son tour, entraîné l’essor des marchés sexuels et la traite des femmes à des fins prostitutionnelles. La Thaïlande a encouragé l’émigration de ses citoyens car cela permettait des rentrées en devise estimées à 485 millions de baht en 1985 et à 45 700 millions de baht en 1995 (Phonpaichit, 1997:79), ce qui s’avère une contribution très appréciable aux comptes courants de la Thaïlande.
L’exemple de la République arabe unie et de l’Arménie
Migration, traite, prostitution, recyclage de l’argent " sale ", corruption, drogue, etc., la criminalité est devenue un moyen particulièrement intéressant d’accumulation du capital du fait, qu’avec sa dimension planétaire, elle constitue l’une des activités les plus rentables de l’économie (Passet et Liberman, 2002:63), entre autres, parce que les coûts et les risques sont minimes (Struense, 2000). Par exemple, les prostituées arméniennes en République arabe unie (RAU), au nombre de 500 pour 20 proxénètes, desservent entre 10 et 30 clients par jour. Elles perçoivent entre 30 et 35 dollars américains par client. Le proxénète les a achetées pour une somme variant de 300 à 500 dollars américains. En une journée ou moins, il a remboursé ses frais. En outre, la prostituée s’est endettée auprès de lui (8).
Les souteneurs saisissent les passeports à l’arrivée. La majorité des femmes qui sont objet de la traite ignore la nature de l’emploi promis. Il n’est pas rare de voir des prostituées âgées de 14 ans. Celles qui se rebellent subissent violence et viol. Ces pratiques brutales perdurent jusqu’à leur arrestation par les autorités de la RAU (pour cause d’absence de visa de long séjour). Après 6 à 9 mois d’emprisonnement, elles sont déportées. Bien sûr, elles n’ont en poche aucun écu (9) (Atomyan, 2000).
La transition capitaliste en Arménie a créé une polarisation sociale extrême, terreau fertile au développement des industries du sexe. La croissance rapide des boîtes de nuit, des bars de danseuses, des saunas, des hôtels, des casinos, bref de l’industrie du divertissement en général en Arménie, a également contribué à l’escalade du phénomène de la traite des femmes et des adolescentes.
Mondialisation du proxénétisme
Les marchés du sexe sont donc largement contrôlés par le crime organisé. La mondialisation de la prostitution n’a pu être opérée que par une mondialisation du proxénétisme (Geadah, 2003:26). Pour Coquart et Huet (2000:242) :
L’internationale du proxénétisme existe. Mais il ne faut pas se l’imaginer comme une construction rigide, homogène et hyper-hiérarchisée […] Cette internationale est une mosaïque d’apparence disparate, une nébuleuse d’associations de malfaiteurs, de gangs ou de clans dont l’importance et le rendement peuvent être aussi différents que ceux qui séparent le gros industriel de l’artisan.
Ainsi, telle organisation locale paiera un tribut à la mafia pour bénéficier de sa protection, tel réseau " approvisionnera " en jeunes femmes les villes. Le crime organisé a souvent recours à une délégation de pouvoir, se focalisant sur la traite seulement, hautement lucrative, et relativement moins risquée que le proxénétisme direct, laissé aux locaux.
Certains réseaux criminels russes peuvent contrôler toute la chaîne, de l’enrôlement à la mise " en marché " des prostituées à l’étranger, mais cela ne représente pas la règle. Les personnes victimes de ces réseaux sont destinées à des " usages " variés:prostitution de rue, salons de massages, services d’escortes, danse nue, bordels clandestins ou Eros centers, ces complexes légaux du sexe. Le crime organisé dans la prostitution des anciens pays " socialistes " d’Europe a eu un impact majeur sur l’industrie du sexe : par exemple, les réseaux ukrainiens contrôlent une grande part des lupanars clandestins à la frontière germano-polonaise. En Australie, avec la légalisation, on a assisté à une explosion de ce genre d’établissements, pour profiter de la " main-d’œuvre " clandestine pourvue par le crime organisé asiatique (Raymond, (2002).
À suivre : « 3. La prostitution soumise à la loi de l’économie néolibérale »
– Bibliographie générale
– Rubrique du dossier intégral.
Notes
1. Un tel argument apparaît réducteur. Par exemple, les historiens n’expliquent pas la naissance de la mafia qu’en des termes de rationalité ou de besoins économiques. Voir à ce sujet, entre autres, Éric Hobsbawm (1966).
2. Le concept de " modernité " est fréquemment employé dans toute une littérature sans que l’on sache à quoi il réfère exactement. Aussi cette prétendue transition vers la modernité implique-t-elle une dégénérescence ou une disparition du crime organisé ? Ou concerne-t-elle la voie prise par des pays comme la Turquie, l’Allemagne ou les Pays-Bas qui ont légalisé la prostitution et le proxénétisme ou par un pays comme la Suède qui tente d’éradiquer la prostitution en s’attaquant aux clients, ou encore par des pays comme le Canada où la prostitution n’est pas illégale, mais la sollicitation l’est (ce qui a pour conséquence de mettre la responsabilité du " crime " surtout sur la prostituée) ?
3. Yann Moulier Boutang (2000) met en évidence que nos sociétés ont assisté à une " transformation progressive, insensible, de la représentation du fait migratoire en activité potentiellement, puis naturellement mafieuse ".
4. Cette thèse est défendue notamment par la criminologie critique, dont Nils Christie (2003) est l’un des plus illustres représentants.
5. Voir le témoignage de Louise Shelley (1997), du Transnational Crime and Corruption Center de Washington devant le Comité des relations internationales de la Chambre des représentants des États-Unis, pour qui le crime organisé est au XXIe siècle, ce que la guerre froide était au XXe siècle et le colonialisme au XIXe siècle. Ce discours incarne une théorisation acritique de la criminalisation croissante des sociétés.
6. Plus précisément, selon l’Article 2, alinéa a, de la Convention des Nations Unies (ONU, 2001:4) contre la criminalité transnationale organisée, " [l]’expression "groupe criminel organisé" désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves […] pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ".
7. Elle est d’autant plus douteuse qu’il ne faut minimiser le fait que " la question que nous devons poser est de savoir quelle différence de fond il y a, pour une femme, une jeune fille, un garçon, d’avoir été acheté, vendu, violé, prostitué par un groupe " organisé ", ou non, par une, trois ou dix personnes, organisées ou non... " (Louis, 2001a). Dans cet article toutefois, c’est le crime organisé, bénéficiant des complicités étatiques et affairistes, qui retient l’attention.
8. Les dettes des prostituées permettent au proxénètes d’établir une système quasi esclavagiste. Les dispositions financières sont si pénibles que la prostituée risque peu de s’en sortir à moins qu’elle ne devient physiquement inutile pour son " propriétaire ". (Pour plus d’informations, voir Bales, 1999).
9. En Turquie, où la prostitution est légale, on estime à 5 000 le nombre de prostituées d’origine arménienne.
LA REVUE TIERS MONDE
La Revue Tiers Monde publie, depuis 1960, les résultats de recherches récentes sur les problèmes que soulève le développement économique et social différencié des États du monde. Complexité du système mondial, diversité des réactions régionales, politiques et expériences de développement sont étudiées par des spécialistes des sciences économiques et sociales, le plus souvent du point de vue théorique ; des études de cas, fondées sur des travaux de terrain originaux, viennent enrichir ces analyses. La Revue Tiers Monde est interdisciplinaire et internationale, par son public et l’origine de ses collaborateurs. Deux à trois numéros par an sont consacrés à un thème, sous la responsabilité d’un spécialiste, les autres sont constitués d’articles divers. Pierre Salama, économiste, en est le directeur.
Adresse url de la Revue Tiers Monde.
Adresse courriel de la Revue Tiers Monde
Site internet de Pierre Salama
© Revue Tiers Monde et Richard Poulin - Reproduction autorisée sur Sisyphe.
 Imprimer ce texte Nous suivre
sur Twitter
Nous suivre sur Facebook Commenter cet article plus bas. Imprimer ce texte Nous suivre
sur Twitter
Nous suivre sur Facebook Commenter cet article plus bas. |


 Plan du site
Plan du site


 Imprimer ce texte
Imprimer ce texte